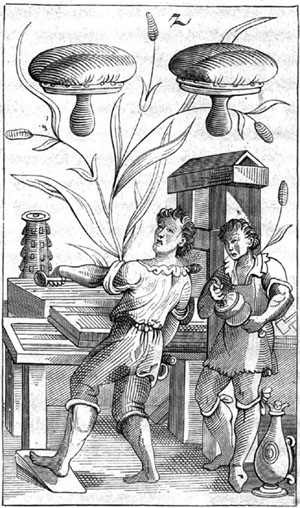|
La
Renaissance Introduction |
|
La
rareté du numéraire avait jusqu'alors entravé le
développement économique. Déjà au temps de
Charles VII,
Jacques Coeur avait si bien
senti le besoin d'accroître la quantité de monnaie qu'il
s'était efforcé d'exploiter des mines de métaux précieux
dans la région de Lyon. Sauf quelques institutions comme la banque
florentine, le crédit n'était pas suffisamment organisé
pour suppléer à l'insuffisance du numéraire. L'or
et l'argent d'Amérique stimulèrent donc beaucoup l'industrie
et le commerce, surtout dans les pays maritimes de l'Europe. |
 Jacques Cœur |
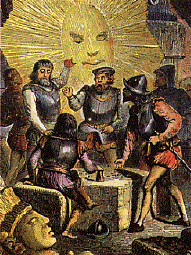 Le disque d'or du Temple du Soleil est joué aux dés entre les soldats espagnols (gravure du XIXe s.) |
L'Espagne
ne garda pas longtemps ses trésors mal acquis. Économiquement
peu développée, faute d'une forte classe bourgeoise qui
consacrât son activité à l’industrie, l'Espagne
se vit obligée d'acheter beaucoup à l'étranger, d'autant
plus que ses établissements d'Amérique augmentaient ses
dépenses. Son or s'en alla bientôt en Italie, en France ou
ailleurs. |
| Les
marchands de Bordeaux, de Rouen, de Dieppe s'enrichirent. Le petit port
breton de Saint-Malo connut alors une grande prospérité.
C'est de là qu'au temps de François 1er partit
Jacques_Cartier qui visita Terre-Neuve et le Canada, où il
fonda Mont-Royal (Montréal) et dont il prit possession au nom du
roi son maître. François 1er lui-même jugea utile de
créer, à côté de la flotte dite du Levant -
celle de la Méditerranée - une flotte du Ponant, c’est-à-dire
de l'Atlantique ; et pour servir de base à cette flotte nouvelle,
il fonda un port nouveau, appelé alors Le Havre de Grâce
(maintenant Le Havre, ch.-l. d'arr. de la Seine-Maritime, sur la rive
nord et à l'embouchure de la Seine, à 208 km de Paris). |
 Jacques Cartier |
 Premiers pas à Montréal |
|
|
|
L'abondance
des métaux précieux eut d'autres conséquences moins
heureuses. Elle causa une hausse des prix dont profitèrent quelques-uns
et dont d'autres souffrirent, particulièrement les ouvriers des
villes, car l'augmentation des salaires ne suivit pas celle des prix.
Il y eut des grèves, malgré leur interdiction, notamment
la grande grève des imprimeurs lyonnais en 1539. |
| La gravure représente une presse à deux coups. Un des ouvriers tire la barre qui entraîne la vis pour faire pression sur la feuille. L'autre tient deux balles pour l'encrage des formes, que l'on retrouve dans la partie supérieure de l'image. Les rouleaux, qui permettent un encrage plus régulier, apparaissent seulement au début du XIXe siècle. | |