Le Moyen Age - Seconde partie
Les Capétiens
Le début du XIIe siècle est marqué par la personnalité d'un moine, Saint Bernard. Nous avons vu plus haut le grand rôle joué par l'abbaye de Cluny. Ce rôle, malheureusement, avait contribué à l'enrichissement de l'ordre et, inévitablement, au relâchement de la discipline. C'est ainsi que, vers la fin du XIe siècle, une nouvelle renaissance bénédictine devint nécessaire. Elle eut lieu à Cîteaux, en Bourgogne, et surtout dans la plus illustre des abbayes cisterciennes qui fut celle de Clairvaux, où Bernard s'installa dès 1112.
Cet homme extraordinaire, qui réunissait en lui deux tempéraments contradictoires : celui d'un moine ascète et mystique et celui d'un homme d'action, à qui obéissaient les papes, les rois et les barons, gouverna, par le prestige de sa sainteté et de son éloquence, toute la chrétienté d'occident, de 1125 à 1153. Sa première œuvre fut d'établir la règle cistercienne, qui s'oppose de manière frappante à la règle clunisienne. Le moine cistercien devait vivre loin des laïques, devait fuir tout ce qui ouvrait l'esprit sur le dehors, sur le siècle, sur les choses profanes. Il devait donc se méfier des livres, de la littérature et de la science ; L'abbaye cistercienne, construite de préférence loin des villes, dans un endroit sauvage, ne pouvait posséder aucune espèce de propriété et ne pouvait exploiter légalement que celles qui étaient utiles au travail manuel des moines : les champs, les vignes, les prés et les bois.
L'ascétisme caractérisait la vie des moines cisterciens : ils ne manageaient jamais de viande, rarement du poisson ; ils vivaient de pois, de lentilles et d'autres légumes sans assaisonnement. Pour se coucher, ils se jetaient tout habillés sur leur lit qui se composait d'un oreiller, de deux couvertures et d'une paillasse. Les cisterciens portaient la robe grise, pour se distinguer des clunisiens à robe noire ; leurs églises étaient simples et nues : pas de vitraux, pas de sculptures ni de mosaïques. «Les œuvres d'art, disait saint Bernard, sont des idoles qui détournent de Dieu et sont bonnes tout au plus à exciter la piété des âmes faibles et des mondains.»
De Clairvaux, le mouvement de réforme gagna l'épiscopat, et Bernard s'occupa même de la papauté. Lorsqu'il y eut, de 1130 à 1138, deux papes élus à Rome, c'est Bernard qui décida lequel serait reconnu et qui imposa sa décision aux souverains européens. Il lutta avec ardeur contre toutes les tentatives que faisait alors la pensée humaine pour secouer le joug de l'Église et se dégager de la tradition. C'est ainsi qu'il entra en conflit avec Abélard, le plus redoutable dialecticien de l'époque, et réussit à le faire condamner par le concile de Sens (1140). La deuxième croisade fut son ouvrage : il la prêcha à Vézelay pendant les fêtes de Pâques 1146, et provoqua les mêmes scènes d'enthousiasme qui s'étaient produites à Clermont. Cette fois, Louis VII le Jeune, le roi de France lui-même, allait prendre la croix.

Louis VII le Jeune
Louis VII avait succédé à son père Louis VI le Gros en 1137, Quelques mois auparavant, il avait épousé Aliénor, l'unique héritière du duc d'Aquitaine. Le domaine royal, à cette époque, était sensiblement le même qu'au temps de Hugues Capet : une longue bande de territoire qui s'étendait de Senlis à Bourges, sur les vallées moyennes de la Seine et de la Loire. Mais Louis VII, en tant que duc d'Aquitaine par son mariage, dominait également tout le territoire au sud de la Loire et à l'ouest du Massif central. Il était donc, au début de son règne, le plus puissant des seigneurs français. Malheureusement, son mariage avec Aliénor ne dura pas. Après quinze ans de vie commune, celle-ci ne lui avait donné aucun fils mais, tout au contraire, de sérieux sujets d'inquiétude conjugale. Dès son retour de la deuxième croisade, qui se termina par un échec, Louis VII répudia Aliénor (1152). Les conséquences de ce divorce furent très graves. Aliénor, deux mois plus tard, épousa Henri Plantagenêt, comte d'Anjou et duc de Normandie, qui devint donc, par surcroît, duc d'Aquitaine. Les Plantagenêt devenaient ainsi incomparablement plus puissants que les Capétiens. Or, en 1154, Henri fut couronné roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. La lutte entre le suzerain et le vassal, devenu roi hors de France, allait s'engager et se prolonger pendant plus d'un siècle.

Louis VII le Gros
Cette lutte, inégale quant aux ressources en biens et en hommes, allait néanmoins profiter moralement à la dynastie capétienne. Le roi de France, comparé à son vassal angevin, semblait mou et inerte, mais, par ses faiblesses mêmes, il apparaissait comme un roi de justice et de grâce. Le Plantagenêt, au contraire, était un être rapace et violent. C'est donc vers le Capétien que se tournèrent les grands vassaux, menacés par les entreprises de Henri II.
A la mort de Louis VII (1180), son fils Philippe II Auguste, dit Philippe-Auguste monta sur le trône. Il avait alors quinze ans, mais ce garçon, grand, fort, énergique et vif, montra immédiatement qu'il entendait régner par lui-même, et régner avec puissance. Il commença par s'allier au comte de Flandre, dont il épousa la nièce, et par s'assurer les comtés de Valois, de Vermandois et d'Amiens. En 1190, il partit, en compagnie du nouveau roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, pour la troisième croisade. Les deux rois qui, quelques années auparavant, étaient d'inséparables compagnons, ne tardèrent pas à trouver des sujets de discorde. Philippe-Auguste, qui tenait par-dessus tout à faire l'union de son royaume, s'impatienta devant la longueur des opérations militaires en Syrie. Après la prise de Saint-Jean-d'Acre (juillet 1191), il décida d'abandonner la croisade et de rentrer en France, après avoir juré de « protéger le territoire et les hommes de la domination angevine ».

Philippe Auguste
De retour en France, Philippe-Auguste commença à préparer l'attaque des terres françaises de Richard. En 1192, ayant reçu la nouvelle de la captivité du roi d'Angleterre en Allemagne, il envahit la Normandie et signa un traité secret avec le frère de Richard, Jean sans Terre. Malheureusement pour ces deux conspirateurs, Richard fut relâché en 1193 et se hâta de retourner à Londres, puis de passer en Normandie.
« Prenez garde à vous maintenant, écrivit Philippe à Jean, le diable est lâché ! »
La guerre devait dure cinq ans, d'abord en Normandie et dans le Berry, puis, après une courte trêve en 1196, qui fut rompue lorsque Richard fit construire Château-Gaillard dans la vallée de la Seine, la guerre s'étendit dans le Beauvaisis et la Flandre. En janvier 1199, 1e pape Innocent III imposa la paix aux deux adversaires et Philippe-Auguste dut renoncer à la plupart de ses conquêtes en Normandie. Heureusement pour lui, Richard fut tué deux mois plus tard en assiégeant le château de Châlus dans le Limousin ; son frère Jean lui succéda sur le trône d'Angleterre.
La guerre entre les deux dynasties reprit en 1202. Cette fois, Philippe-Auguste réussit à conquérir la Normandie ainsi que les provinces de la Loire et même une partie du Poitou. Effrayés par les conquêtes capétiennes, les seigneurs de Flandre entrèrent dans la coalition formée par le roi d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne Othon IV. La Flandre à ce moment, était, en occident, la région industrielle par excellence et faisait son principal commerce avec l'Angleterre. Une rupture avec ce pays eût signifié la ruine des marchands flamands ; ceci prévalut toujours contre les devoirs de vassalité et les sympathies qui entraînaient les seigneurs de Flandre du côté de la France et des Capétiens.
Cette coalition entre la Flandre, l'Allemagne et l'Angleterre, fut, au début, victorieuse contre le roi de France. En 1214, cependant, le fils du roi, Louis de France, futur Louis VIII, battit Jean sans Terre à la Roche-au-Moine dans le Poitou (le 2 juillet), tandis que Philippe-Auguste triomphait à Bouvines des Flamands et de l'empereur germanique. On ne saurait exagérer l'importance de ces deux victoires, et surtout de la seconde. En cas de défaite, il est fort probable que Philippe-Auguste aurait perdu sa couronne et que Jean sans Terre serait devenu roi de France et d'Angleterre. La France, d'autre part, aurait subi de graves amputations à l'est.
La victoire, au contraire, servit à consolider la dynastie capétienne de diverses manières. Le domaine royal fut presque doublé ; la Flandre perdit sa quasi-indépendance ; le roi d'Angleterre ne garda en France que la Saintonge et la Gascogne et l'un des effets les plus importants, pour les Anglais de la bataille de Bouvines fut la Grande Charte, imposée à Jean sans Terre par ses barons, le 15 juin 1215. Quant à l'empereur Othon, il fut remplacé par Frédéric Il, un ami de la France. Philippe-Auguste était alors arrivé au point culminant de sa carrière. Il avait, par la politique et les armes, rendu la royauté maîtresse de la France et avait placé celle-ci au premier plan en Europe.
Un autre événement de grande importance eut lieu également en ce premier quart du XIIIe siècle : la croisade des Albigeois ou Cathares .
Le Midi n'avait, jusqu'alors, jamais été rattaché au reste du royaume. Sous les Mérovingiens et les Carolingiens, l'Aquitaine avait mené une vie à part. Au Xe siècle, deux grandes maisons, celle de Poitiers et celle de Toulouse, s'étaient partagé le territoire au sud de la Loire. La civilisation de cette partie de la France était, à l'époque de Philippe-Auguste, plus raffinée que celle des pays du nord. Le Midi, tout naturellement, tendait à l'autonomie sur le terrain politique, dans le domaine de la culture et même de la religion. Au XIIe siècle, en effet, l'hérésie cathare (voir note 109) s'était répandue dans tout le Midi, appuyée par l'aristocratie locale. Par la suite, cette hérésie prit le nom d'« albigeoise », parce que la ville d'Albi était au centre de la région où les hérétiques étaient les plus nombreux.
En 1208, le pape Innocent III, voyant que l'hérésie risquait de se propager de tous côtés, lança contre elle une croisade. Philippe-Auguste, trop occupé à se battre contre les Anglais n'y participa pas, mais un grand nombre de seigneurs français du Nord prirent les armes à l'appel du pape. Sous le commandement de Simon de Monfort (voir note 109), une armée de 50.000 hommes descendit le Rhône et se mit à ravager le Midi. La guerre contre les hérétiques allait durer quinze ans, pendant lesquels presque toutes les villes et tous les châteaux forts de cette malheureuse région furent pris, perdus, repris, pillés, saccagés, brûlés et la population massacrée par les croisés. On raconte qu'un des chefs de la croisade, Arnauld Amaury, qui était abbé de Cîteaux, répondit aux vainqueurs de Béziers, en 1209, qui lui demandaient comment, dans l'assaut de la ville, ils distingueraient les hérétiques des fidèles : « Tuez-les tous ! Dieu connaîtra bien les siens. »
Ce fut une guerre atroce, d'autant plus que le pape avait promis aux croisés la souveraineté des domaines qu'ils conquerraient. De loin, Philippe-Auguste surveillait les événements. Après la victoire de 1214 contre les coalisés, il laissa son fils, le prince Louis, se rendre auprès de Simon de Montfort, et, en 1218, après la mort de Simon, il l'envoya une deuxième fois en Languedoc pour aider Amaury de Montfort, qui avait succédé à son père en tant que chef de la croisade.
Ce n'est qu'après la mort de Philippe-Auguste (1223) que l'affaire albigeoise fut réglée. Par le traité de Paris en 1229, le comte de Toulouse, en mariant sa fille et unique héritière au frère du roi Louis IX, Alphonse de Poitiers, concédait son fief à la couronne de France.
Le fils de Philippe-Auguste, Louis VIII le Lion, ne régna que trois ans. Il avait hérité d'un grand royaume, d'une couronne incontestée, et d'un pouvoir respecté. Il continua la guerre contre les Plantagenêt et s'empara du Poitou en 1224. L'expédition qu'il entreprit contre les Albigeois en 1226 prépara la reddition finale des hérétiques. Son fils, Louis IX, n'avait que douze ans lorsqu'il devint roi. Sa mère, Blanche de Castille, avait été désignée comme régente et exerça cette charge jusqu'en 1234.
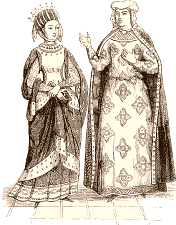
Banche de Castille