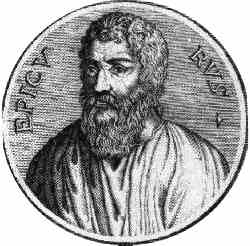| LA
RENAISSANCE VI L’HUMANISME – LES BELLES LETTRES |
|
Au commencement du seizième
siècle, la ville de Lyon, avec sa cinquantaine d'ateliers, était
le grand centre de l'imprimerie en France (en France, la première
presse à imprimer fut installée à la Sorbonne en
1470). Bon nombre d'imprimeurs étaient en même temps des
humanistes. Henri Estienne, par exemple, appartenait à une illustre
famille d'imprimeurs lyonnais. L'imprimerie a donc facilité les
études nouvelles. Mais des presses sortaient toute sorte d'ouvrages,
Évangiles, ouvrages scientifiques, scolaires, populaires. Les vieux
romans de chevalerie étaient encore souvent imprimés en
caractères imitant l'écriture des manuscrits, alors que
pour les ouvrages plus modernes on utilisait les caractères de
la minuscule carolin-gienne, déjà employés par les
Italiens. Pour favoriser l'impression d'ouvrages de l'antiquité
grecque, François 1er fit fondre à ses frais de fort beaux
caractères qu'on appela «les grecs du roi ». |
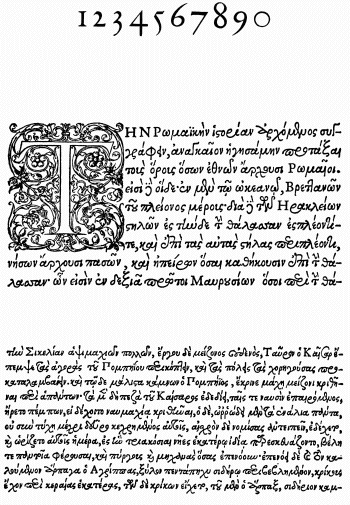 « Les grecs du Roi » |
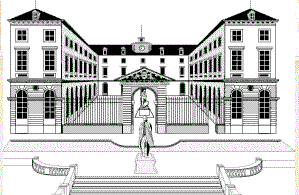 Le Collège de France |
C'est Guillaume Budé qui en avait donné l'idée à François 1er. Il lui en donna une autre : celle de fonder un collège qui, en face de la Sorbonne, asile de la théologie médiévale, serait le centre des études humanistes. Des « lecteurs royaux » y enseigneraient le grec, l'hébreu, le latin sur des textes établis d'après les méthodes critiques les plus récentes. Le collège fut fondé en 1530. Il existe encore et il est resté fidèle à l'esprit de sa fondation. C'est le Collège de France, composé de spécialistes dans les diverses disciplines littéraires et scientifiques. Les quelques cours publics qu'ils enseignent leur laissent le temps dont ils ont besoin pour leurs travaux savants. |
Cet intérêt passionné
pour l'Antiquité, cette admiration sans bornes pour les Anciens,
risquait d'amener un retour à la pensée antique, qui sur
bien des points était en contradiction avec la pensée chrétienne.
Le conflit fut pourtant beaucoup moins prononcé et moins violent
qu'on ne serait tenté de le croire. Certes les humanistes, comme
les protestants, dénonçaient les abus de l'Église
romaine. D'ordinaire leur critique s'arrêtait là, ils séparaient
leur vie intellectuelle de leur vie religieuse. Ce n'était pas
la faute des Grecs et des Romains, pensaient-ils, s'ils n'avaient pas
connu la religion révélée. Eux, dans l'ensemble,
l'acceptaient comme telle. La plupart ne voyaient pas de contradiction
profonde entre pensée païenne et pensée chrétienne. |
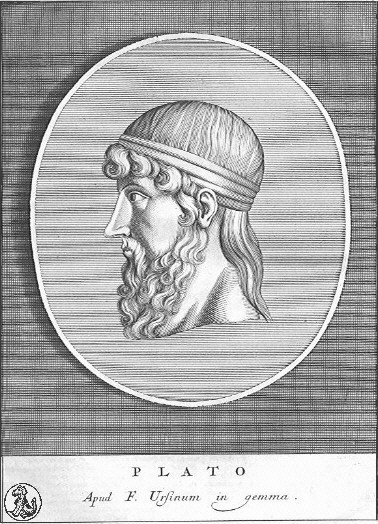 Platon, portrait de la Renaissance |
|
|
Lorsque, vers la fin du siècle surtout, les morales
antiques attirèrent de plus en plus l'attention, les données
de la morale stoïcienne et de la morale épicurienne ne semblèrent
nullement incompatibles avec celles de la morale chrétienne. Qui
peut trouver à redire à la sagesse stoïcienne d'acceptation
de l'inévitable ? Il suffit de remplacer l'idée païenne
de l'ordre du monde par celle, chrétienne, de pro-vidence. L'épicurisme,
avec sa doctrine de modération et de juste milieu, est-il condamnable
? Le scepticisme même, en faisant table rase des idées reçues,
n’est-il pas une espèce de préparation à la
foi ? |
L'attitude des humanistes envers la Réforme
fut diverse et influencée par le cours des événements.
Le protestantisme à ses débuts avait de quoi les attirer
- sa dénonciation des abus de l'Église, son hostilité
envers la tradition médiévale, son intention de remonter
aux sources de l'Écriture - l'hébreu pour l'Ancien Testament
et le grec pour le Nouveau. Bon nombre d'humanistes furent favorables
à Luther. Mais leur enthousiasme se refroidit en présence
de Calvin. Ce dernier était lui-même un humaniste, à
sa façon. Néanmoins il n'aimait pas les humanistes, qu'il
accusait à la fois d’arrogance et de lâcheté,
alors qu'eux considéraient les huguenots comme des perturbateurs
de la paix publique. Ronsard, dans ses Discours, les accuse de désoler
le royaume, les rend responsables des misères de la guerre civile.
Hommes de leur temps, les humanistes ne furent souvent tolérants
que dans la mesure où ils avaient eux-mêmes besoin de la
tolérance. |
.jpg) Ronsard, Discours des misères de ce temps |