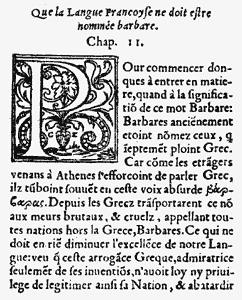| LA
RENAISSANCE VI L’HUMANISME – LES BELLES LETTRES |
|
Rabelais, l'auteur
de Gargantua (1534) et de Pantagruel est un admirable exemple de l'humaniste
des lettres pendant la première Renaissance. Sa curiosité
est insatiable, son savoir énorme, son enthousiasme immense, comme
son géant. Il est heureux de vivre, heureux de vivre en son temps.
Certes il y trouve beaucoup à critiquer et il ne se prive pas de
le faire. Il dénonce, ridiculise tout ce qui assombrit l'exis-tence,
tout ce qui entrave le libre développement de l'homme - la discipline
inhumaine des collèges, la sotte ambition de Picrochole, le conquérant
qui fait le malheur de tant d'innocents, la règle monastique qui
impose abstinences et privations. Lui aime la liberté, le bon vin,
la bonne chère, et l’étude. |
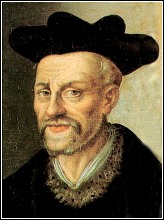 Rabelais |
 Pantagruel bébé par Gustave Doré |
|
 Rabelais, Les Essais, illustré par Gustave Doré : "Grandgousier estoit bon raillard en son temps, aymant a boyre net autant que homme qui pour lors fust au monde, et mangeoit voluntiers sale". Gargantua, chapitre 3. |
C'est l'homme le moins ascétique qui soit au monde. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de l'état ecclésiastique, Rabelais éprouve une espèce d'attrait pour ce qu'il critique. Frère Jean des Entommeures est un moine bien sympathique. Si Rabelais rêve d'une utopie, il l'imagine sous l'aspect d'une abbaye, l'abbaye de Thélème, affranchie de toute règle si ce n'est « Fais ce que vouldras », mais abbaye tout de même... Son œuvre, écrite avec une verve étonnante, mélange de plaisanteries et de choses sérieuses, est non seulement une des grandes œuvres de la littérature française, mais aussi un témoignage de l'extrême complexité de l’homme de la Renaissance. |
La langue de Rabelais est d'une grande richesse.
Il a puisé partout ses moyens d'expression. Archaïsmes, provincialismes,
latinismes, néologismes abondent dans son œuvre, et il les
manie tous avec une dextérité étonnante. Les poètes
en particulier eurent le sentiment que la langue héritée
du Moyen Age était trop pauvre pour la poésie nouvelle. |
 Page de titre de Pantagruel Édition princeps de 1532 |
|
|
Dans sa Défense et illustration de
la langue française, Du Bellay proposa d’enrichir la langue
poétique par des emprunts aux langues étrangères
– latin, grec, italien - dont le génie lui paraissait conforme
à celui du français. Ronsard recommandait les mêmes
procédés, en insistant sur la création de mots nouveaux
d'après des mots déjà existants. De toutes ces tentatives
résulta une langue poétique assez savante, parfois bizarre
- avec des composés tels que « doux-amer » ou «
porte-flambeaux » - mais plus riche, plus complexe et plus souple
qu'elle ne l'était autrefois. |
| Que
la langue française ne doit être nommée barbare. Chap.II Pour commencer donc à entrer en matière, quant à la signification de ce mot Barbare : Barbares anciennement etoient nommez ceux, qui ineptement parloint Grec. Car comme les etrangers venans à Athenes s'efforcoint de parler Grec, ilz tumboint souvent en cette voix absurde barbare Depuis les Grecz transportarent ce nom aux meurs brutaux, &t cruelz, appellant toutes nations hors la Grece, Barbares. Ce qui ne doit en rien diminuer l'excellence de notre Langue: veu que ceste arrogance Grecque, admiratrice seulement de ses inventions, n'avoit loy ny privilege de legitimer ainsi sa Nation, & abatardir |
|