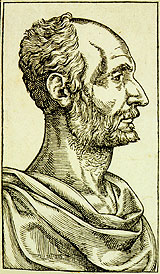| LA
RENAISSANCE VI L’HUMANISME – LES BELLES LETTRES |
|
Lyon était alors une
ville active et prospère par son industrie de la soie et par sa
banque, qu'avaient introduites les Italiens. C'était aussi un centre
culturel. La bourgeoisie lyonnaise s'intéressait aux belles-lettres.
Avec Louise Labé et Maurice Scève, Lyon fut, avec Paris,
un des foyers de la Renaissance poétique. Mais le grand poète
du temps, celui qui fut presque universellement respecté et admiré c'est Ronsard. |
 Louise Labé |
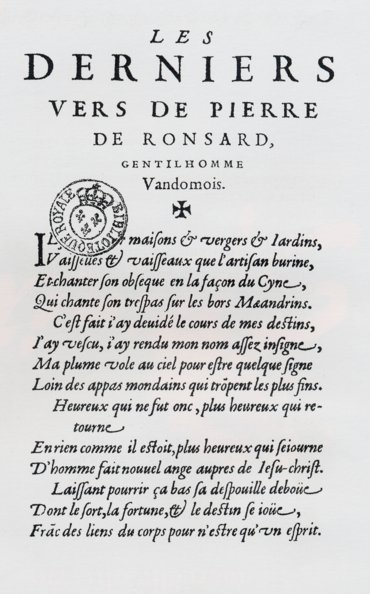 Ronsard, Derniers vers |
Protégé des rois, surtout de Charles IX qui le combla de faveurs, Ronsard a laissé une œuvre lyrique considérable, des odes, des élégies, des hymnes, des sonnets. Même si, avec le merveilleux sens du rythme qui était le sien, il emploie encore parfois des mètres poétiques du Moyen Age, il s'attache aux genres restaurés de l'Antiquité. Les sources de son inspiration sont la Grèce, l'Italie ancienne et moderne. |
Dans ses odes, il s'inspire d'Horace, de
Pindare et d'Anacréon, dans ses élégies de Tibulle,
dans ses sonnets - genre italien - de Pétrarque. Sa poésie
est éminemment sensuelle, sa vision des êtres et des choses
est toute païenne. L'amour et la mort, la fuite du temps, la fragilité
de la vie humaine et l'appel désespéré à jouir
de cette vie avant qu'il ne soit trop tard sont ses thèmes habituels.
Il voit volontiers la nature à travers les anciens mythes, il peuple
ses forêts de sylvains, ses eaux de naïades. Ses meilleurs
poèmes - car il est inégal et son inspiration est parfois
livresque - ont une grâce, une puissance de suggestion ou une plénitude
qui n'avaient jamais été atteintes en France avant lui,
du moins dans ce genre de poésie. |
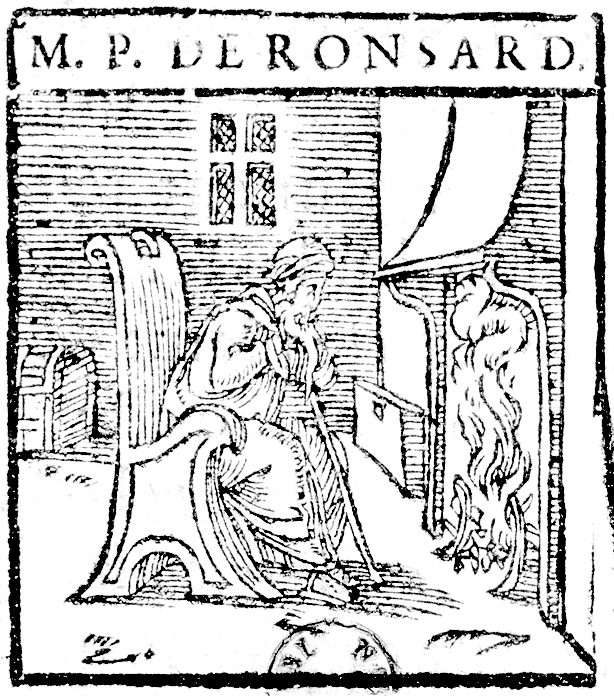 Ronsard, Sonnets pour Hélène, II, XLIII : Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, Assise auprès du feu, dévidant et filant, Direz chantant mes vers, en vous émerveillant : « Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.» |
|
|
Autour de Ronsard se forma un groupe de poètes
qui est resté célèbre sous le nom de « la Pléiade
». Ils étaient sept, comme le nombre des étoiles dans
la constellation qui porte ce nom. Nul d'entre eux n'égala Ronsard,
Belleau, Baïf ne furent que des étoiles de moindre grandeur. |
Bien plus original fut, vers
la fin du siècle, Agrippa d'Aubigné. Ses Tragiques sont
une espèce d'épopée des guerres religieuses. Chez
ce chef huguenot, la puissance d’invective se joint à une
extraordinaire puissance d’évocation de cette période
tourmentée. Sa poésie tendue, violente, où la ferveur
religieuse se mêle à l'éclat des images empruntées
aux saisons, aux éléments, aux choses naturelles est dans
la tradition de la Pléiade, mais avec quelque chose de plus. Les
thèmes de l'instabilité, du changement, de la métamorphose
aboutissent à une vision apocalyptique du monde, à une sensibilité
nerveuse, désordonnée, à une acuité des sensations
visuelles, auditives et autres, qu'on a essayé de caractériser
par le terme de « baroque » donné quelquefois à
la littérature de la fin du seizième siècle et du
début du siècle suivant. |
 Agrippa d’Aubigné |
 Les Tragiques, Première page de l’édition princeps, 1616 |
|